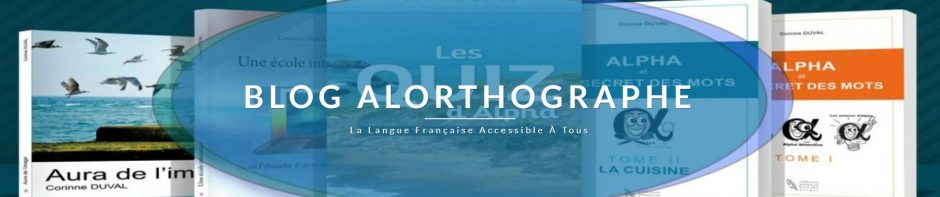Les deux verbes démystifier et démythifier ont un rapport avec le principe de mythe, mais ne s’utilisent pas dans les mêmes circonstances. Démystifier, c’est détromper, la mystification désignant l’imposture, l’action de tromper, la duperie, la supercherie. La mystification peut être comprise comme un mythe moral ou intellectuel. Démystifier, ce peut être aussi montrer la vraie nature de quelque chose, la vérité, rendre banal, retirer son côté mystérieux afin de faire tomber un mythe, mais cet emploi est parfois critiqué notamment en raison de l’étymologie du mot, comme nous allons l’expliquer plus loin. Il est préférable d’employer dans ce cas le verbe démythifier qui signifie ‘ enlever le mythe ‘. Exemple : ‘ La divulgation publique de sa vie dissolue a contribué à démythifier cette star internationale. ‘ Côté étymologie, mystifier, comme mystère, vient du latin mysterium, issu du grec mustêrion, de mustês qui signifie ‘ initié ‘. L’initié est celui qui sait. Un mystère, par principe, n’est pas élucidé (sauf par des initiés éventuels qui en connaissent les secrets), il pose question, sinon ce n’est plus un mystère. Le mythe quant à lui possède une étymologie différente, c’est un mot qui vient du bas latin mythus, issu du grec muthos qui signifie ‘ récit, légende ‘. Une légende n’étant pas une histoire vraie, tout comme un conte, nous retrouvons ici la notion de fausseté, de tromperie en quelque sorte, vis-à-vis de la réalité mais transmettant malgré tout des vérités, sous forme déguisée. Le philosophe Gaston Bachelard disait : ‘ tout l’humain est engagé dans le mythe ‘. Le mythe est un récit tenu pour vrai, mais dans un système de croyances déterminées et en apparence opposé au discours rationnel, il s’oppose au logos (raison, parole). Le terme de mythologie (XVIe siècle) désigne d’ailleurs l’ensemble des mythes et légendes des diverses civilisations mais se rapporte également à des thèmes particuliers contemporains que l’on peut retrouver au sein de collectivités, comme par exemple les légendes urbaines.
-
Articles récents
- Différence entre somptueux et somptuaire
- Hébertisme deux notions
- Qu’est-ce que l’évergétisme ?
- Différence entre cachemire et mohair
- Différence entre pistil et étamine
- Alphabet, esperluette, consonne et voyelle
- Différence entre dureté et durabilité
- Différence entre merroir et terroir
- Différence entre avent et avant
- Différence entre langue et langage
Archives
Catégories
Pages
Étiquettes
- accord
- adjectif
- animal
- Antiquité
- aromatique
- astuce
- barbarisme
- confusion
- coq
- Covid-19
- différence
- droit
- eau
- expression
- fromage
- féminin
- fête
- histoire
- homonymes
- homophones
- langue française
- latin
- livre
- locution
- maison
- masculin
- mer
- nom
- origine
- orthographe
- Paris
- plante
- plat
- pluriel
- pléonasme
- politique
- préfixes
- pâte
- règle
- signification
- verbe
- verbes
- vidéo
- YouTube
- étymologie
Les visiteurs
Your IP: 18.191.216.163Méta