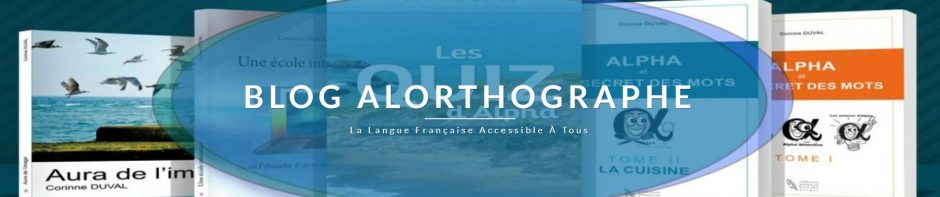Astuce mnémotechnique en vidéo pour ne plus se tromper dans l’écriture de balade et ballade, par Corinne Duval conseillère en communication écrite.
-
Articles récents
- Ne pas confondre additif et addictif
- De fil en aiguille origine de l’expression
- Origine de l’expression mi-figue mi-raisin
- Différence entre téléphérique, télécabine et funiculaire
- La bergamote, un agrume méconnu
- Différence entre les physalies et les vélelles
- Origine du chèque en bois
- Différence entre cigogne, vigogne et gigogne
- Différence entre action et obligation
- Cruciverbiste et verbicruciste quelles différences
Archives
Catégories
Pages
Étiquettes
- accord
- adjectif
- animal
- Antiquité
- astuce
- barbarisme
- beurre
- confusion
- Covid-19
- différence
- droit
- eau
- expression
- fromage
- féminin
- fête
- histoire
- homonymes
- homophones
- langue française
- latin
- livre
- locution
- maison
- masculin
- mer
- oiseau
- origine
- orthographe
- Paris
- plante
- plat
- pluriel
- pléonasme
- politique
- préfixes
- pâte
- Rome
- règle
- signification
- verbe
- verbes
- vidéo
- YouTube
- étymologie
Les visiteurs
Your IP: 216.73.216.10Méta