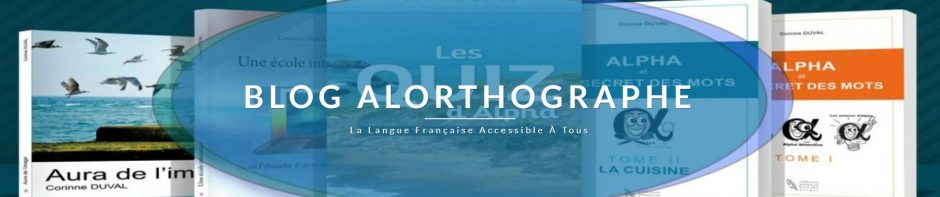Hommage national ou hommage populaire ? Ce n’est pas la même chose, voici les différences pour mieux y voir clair.
L’ancien Président de la République française Jacques Chirac va recevoir un hommage dit populaire, celui-ci étant plus libre, moins formel que l’hommage national, à savoir que l’accès est ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer, sans besoin d’une invitation spéciale. La cérémonie d’hommage national est quant à elle inscrite au Journal Officiel et se déroule soit au Panthéon, soit dans la cour des Invalides. Le dispositif est très strict, le cercueil est recouvert d’un drapeau tricolore et l’on ne peut y accéder que sur invitation. Celui-ci étant réservé aux militaires et personnages ayant particulièrement marqué la République, et avant la Révolution française uniquement au roi et à sa famille, Jacques Chirac aurait pu bénéficier d’un hommage national mais sa famille a préféré un hommage populaire dans la cour des Invalides en raison de sa relation forte avec les Français quel que soit leur penchant politique et de la grande popularité dont il jouissait. Un livre d’or est mis à la disposition de ceux qui souhaitent y écrire un petit mot.