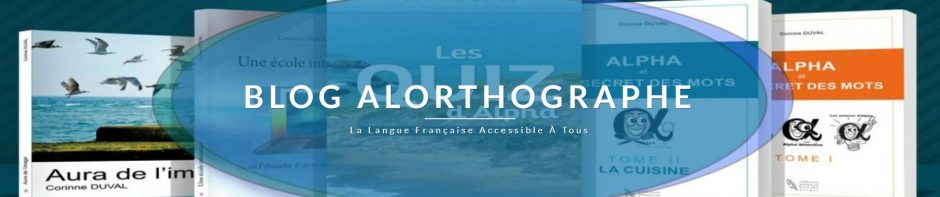Voici deux mots qui se ressemblent à une lettre près, facilement confondus : additif et addictif.
Le terme « additif » est utilisé soit comme adjectif, avec comme féminin additive, et signifie « qui s’ajoute » (exemple : des prix additifs), soit comme nom masculin et désignant un supplément, un article additionnel (exemple : un additif au contrat), ou alors une substance ajoutée à un produit dont le but est de le conserver ou (censé…) en améliorer les propriétés ou la durabilité (exemple : un additif alimentaire).
Côté étymologie, le terme « additif » est emprunté au bas latin additivus signifiant « qui se joint à » et issu du verbe latin addere = attacher. Même si le mot lui-même est assez récent, datant de la moitié du XIXe siècle, les additifs existent depuis l’Antiquité, servant à conserver les aliments notamment, par exemple le sel et la saumure.
Le terme « addictif » quant à lui est un adjectif (addictive au féminin) désignant tout ce qui est susceptible de provoquer une dépendance, l’addiction. Le nom « addiction », côté étymologie, vient du verbe latin addicere = dire pour, s’adonner ou se vouer à quelque chose. D’ailleurs, dans le droit romain, l’adjectif addictus désignait un esclave pour dette, signifiant assigné, livré. En effet, et cela jusqu’au Moyen Âge en Europe occidentale, quand une personne n’arrivait pas à rembourser une dette ou était incapable d’assumer ses responsabilités, elle était condamnée à devenir esclave addictus du plaignant et payer ou rembourser de ce fait par l’utilisation de son propre corps. Elle était libérée seulement quand le plaignant jugeait que la dette était remboursée.