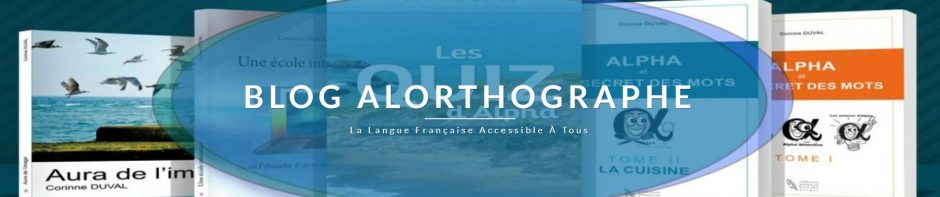L’adjectif « rocambolesque » désigne une situation invraisemblable, pleine de péripéties, farfelue, extravagante, incroyable. Il faut remonter au XIXe siècle pour en trouver l’origine.
En effet, à cette époque, le seul moyen pour se cultiver était la lecture. Il existait notamment des romans-feuilletons, écrits par des romanciers pour se faire connaître et fidéliser les lecteurs. Alexandre Dumas, Honoré de Balzac ou Eugène Sue en ont écrit un certain nombre. Intéressons-nous maintenant à Pierre Alexis de Ponson du Terrail (1829-1871) qui inventa un héros bien particulier à qui il arrivait des aventures invraisemblables et vite devenu célèbre, Rocambole. Ce personnage apparut au total dans 9 romans contenant chacun plusieurs parties, mais pas plus, l’auteur étant décédé prématurément à 42 ans après avoir participé à la guerre de 1870.
Les aventures de Rocambole furent publiées pour la première fois sous forme de feuilleton dans le journal La Patrie (du 21 juillet au 4 octobre 1857) à l’occasion de l’écriture de son premier roman Les Drames de Paris : « Les exploits de Rocambole » en octobre 1858 où ce héros devient le personnage principal, « Le dernier mot de Rocambole », « La Résurrection de Rocambole », « Les Misères de Londres », « La Corde du Pendu », « L’Héritage mystérieux »,…
Le héros Rocambole, français, était un criminel revenu à Paris après un séjour à Londres. Mais son astuce, afin d’échapper à la police, consista à se déguiser en dandy romantique pour commettre ses crimes. Son imposture fut découverte et il fut envoyé au bagne puis il se racheta en devenant bon envers une orpheline spoliée de son héritage.
Les aventures de Rocambole furent publiées au final dans plusieurs journaux (La Patrie, Le Petit Journal, La Petite Presse) sous forme de roman-feuilleton jusqu’en 1870.
L’adjectif « rocambolesque » fut attesté dès 1898 selon Le Petit Robert.