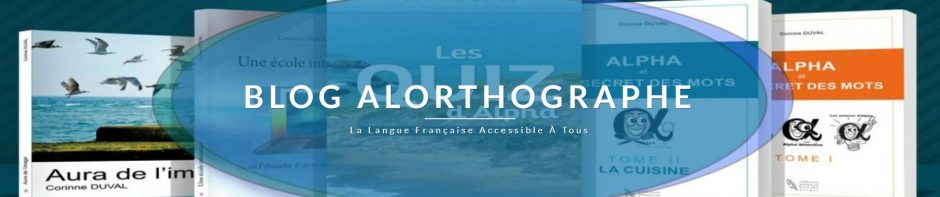Le butane est un hydrocarbure saturé de formule N-butane et isobutane C4H10 et provient uniquement de raffineries. Utilisé sous forme de bouteille, il est essentiellement utilisé comme combustible notamment à l’intérieur d’un bâtiment pour faire la cuisine. Le butane n’est pas prévu pour être utilisé à l’extérieur. Son point d’ébullition/liquéfaction se situe à 0°C. Il est plus lourd que l’air. C’est un GPL (gaz de pétrole liquéfié).
Le propane est un hydrocarbure saturé gazeux de formule C3H8, employé comme combustible dans les moteurs à combustion interne, les barbecues et les chaudières. C’est un GPL (gaz de pétrole liquéfié) qui provient de champs ou de raffineries.
Un additif odorant, l’éthanethiol, lui est ajouté pour signaler les fuites. Son point d’ébullition particulièrement bas (-42 ° C) lui donne l’avantage de pouvoir être utilisé à l’extérieur, ce qui est pratique pendant l’hiver. Il est plus lourd que l’air.
Le gaz naturel est distribué par le réseau. Il est propre et non toxique, issu de champs : son principal composé chimique est le méthane CH4. Pour rendre le gaz odorant, on y ajoute du THT. Plus léger que l’air, il est distribué sous forme gazeuse, car son transport en phase liquide est difficile. Précisons qu’historiquement, le gaz de ville et le gaz naturel provenaient de deux sources distinctes, le gaz de ville provenant de la distillation de la houille (charbon) alimentant les réseaux urbains donc différent du gaz naturel issu de champs. Malheureusement, ce gaz dit manufacturé, contenait du monoxyde de carbone, très toxique. Les usines à gaz appelées aussi cokeries qui le fabriquaient ont donc disparu et il n’y a plus de gaz de ville aujourd’hui en France. Il a été remplacé par le gaz naturel propre et non toxique, dès 1920 aux États-Unis et dès 1960 en Europe. En France, la dernière cokerie, située à Belfort, fut fermée en 1971.
Testez votre culture générale avec LES QUIZ D’ALPHA chez TBE et AMAZON
Entrez dans les secrets de la langue française tout en vous amusant avec ALPHA ET LE SECRET DES MOTS , de Corinne DUVAL, un livre tous publics écrit par une professionnelle de la langue française : thebookedition.com/corinne-duval-alpha-et-le-secret-des-mots ou amazon.fr/Alpha-secret-mots-Corinne-DUVAL